

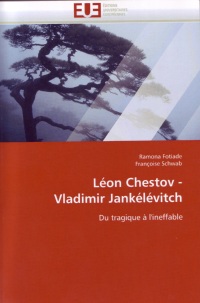
Parution de Léon Chestov-Vladimir Jankélévitch
Ramona Fotiade/Françoise Schawb
2011
La parution du volume Léon Chestov-Vladimir Jankélévitch. Du tragique à l'ineffable, 238 p. ISBN: 978-613-1-56480-2 dirigé par Ramona Fotiade, directrice de la Société des Etudes Léon Chestov et Françoise Schawb directrice de la L'Association Vladimir Jankélévitch aux Editions Universitaires Européennes était attendue. Cet ouvrage rassemble des communications de spécialistes internationaux qui explorent les croisements philosophiques entre les oeuvres respectives, en analysant leurs façons d'assouplir ou de marquer les limites de la rationalité. Des contributions de Benjamin Guérin et de Nicolas Monseu analysent conjointement les approches chestovienne et fondanienne à l'égard de Kierkegaard (Benjamin Guérin) et de la phénoménologie (Nicolas Monseu). Nous reproduisons ici l'introduction du volume: